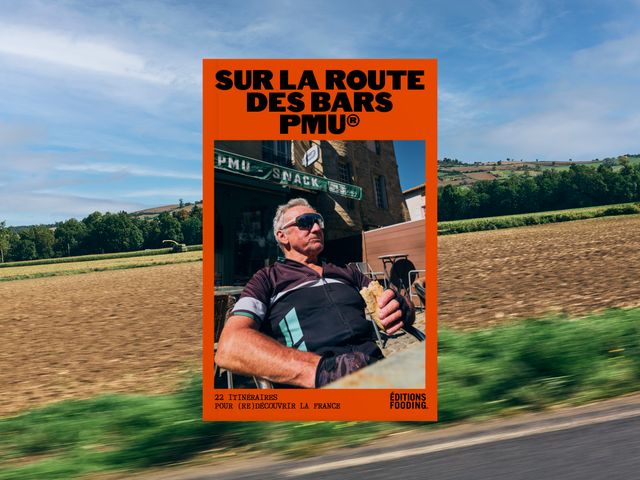En ce début de mois de juillet, le Refuge de Porcherey, perché à 1 717 mètres d’altitude au-dessus du val Montjoie, a tout d’un coin de paradis : des températures qui défient la canicule, un paysage de carte postale sublimé par l’aiguille du Bionnassay, le tintement des clarines qui sillonnent les alpages en fond sonore. Sur la terrasse, les pauses café des trois saisonnier·ères sont encore assez nombreuses avant le rush de l’été : « C’est très calme en juin et jusqu’à fin juillet. Après, c’est pleine balle jusqu’à la coupure en septembre », détaille Alexia Coste, qui gère le lieu avec son compagnon Loïc Audebert. L’été, on y parvient en vingt minutes à pied depuis le parking du Plateau de la Croix ; l’hiver, via une piste du domaine skiable de Saint-Gervais.
Toute une année en quelques mois
Arrivé·es « par hasard » au refuge il y a une dizaine d’années, après des études d’art pour l’une, un apprentissage en cuisine pour l’autre, ils ont finalement repris la gérance il y a deux ans. Dans ce chalet tout de planches noircies, leur vie est bercée par le rythme saisonnier : « On travaille environ quatre mois l’été, quatre l’hiver, et le reste, c’est quatre mois de pures vacances. »
Si ce cadre de vie fait rêver, Alexia précise que lors de la mise en suspens de leur activité, il leur reste tout de même le loyer du refuge ainsi que les charges personnelles à payer. Et même s’ils sont propriétaires de leur logement à Saint-Gervais-les-Bains, ils doivent mettre les bouchées doubles pour assurer leur rentabilité, et ne pas avoir à compenser avec une autre activité le reste de l’année. Alors, « pendant huit mois, on enchaîne des semaines entre 90 et 95 heures », confie la gardienne de 37 ans, qui s’occupe à la fois du service, du nettoyage, du bricolage et du jardinage, aidée par deux saisonnier·ères.

Refuge de Porcherey (Saint-Nicolas de Véroce)
© Julie Zane
En raison de sa localisation en altitude, Alexia et Loïc ont dû mettre en place une logistique bien rodée pour acheminer les provisions du restaurant depuis la ville. Chaque matin, le couple remonte donc en 4×4 les denrées qui sont stockées dans une chambre froide à son domicile, situé à une quarantaine de minutes du refuge. De quoi concocter les menus qui font leur réputation, comme ce jour-là, avec la mythique salade fleurie du chalet, puis un jarret de veau de Haute-Savoie braisé, escorté de chou-fleur et pêches rôtis cernés de feta fumée, avant un dessert maison au choix – le tout pour 36 euros.
Une course d’obstacles
Reste que cette accessibilité est une chance dont ne bénéficient pas tous·tes les restaurateur·rices en montagne. Si certain·es sont contraint·es de ravitailler en hélico leur établissement plus haut perché, à la Buvette du Chapeau, à une cinquantaine de kilomètres de Porcherey, c’est encore une autre histoire. Thierry Couttet gère depuis quatorze ans cet établissement construit par ses grands-parents, ouvert toute la journée et onze mois dans l’année. Il y restaure les baroudeur·ses pour moins de 30 euros avec des planches de fromages et charcuteries des fermes voisines, des croquettes de reblochon, un plat du jour et des tartes et gâteaux maison.
À la différence du refuge, la buvette, campée à 1 576 mètres d’altitude face à la mer de Glace, est très isolée : elle n’est accessible que par les sentiers, et distante d’une quarantaine de minutes à pied du village voisin. L’un des critères de recrutement de Thierry Couttet ? « Être sportif », puisqu’en pleine saison les stocks de produits frais sont rapidement épuisés. Chaque jour, il descend donc de sa montagne pour regagner sa voiture et être à 6 heures du matin devant les magasins. Puis avec son équipe, qui habite dans la vallée, ils remontent le tout sur leur dos à l’aide d’une claie de portage, avant l’ouverture de l’établissement à 10h. Mais pour lui, ce n’est pas vraiment un problème : « J’adore porter. Je suis fou de portage ! »

Restaurant Chez Pépé Nicolas (Val Thorens)
© Léa Brochot
D’autres ont carrément fait le choix de se rapprocher de l’autosuffisance pour réduire les contraintes liées à l’approvisionnement. Au cœur du domaine skiable des 3 Vallées, le restaurant Chez Pépé Nicolas, tenu par Margot Suchet, dispose d’une ferme et d’un jardin en permaculture. Le site produit ainsi fromages, salades, aromates, fleurs comestibles, quelques fruits et légumes, tandis que le reste est acheminé en quad depuis le parking, situé 200 mètres plus bas, où sont réceptionnées les livraisons des producteur·rices du coin. Malgré cela, les moyens humains nécessaires à cette organisation sont bien plus importants que pour les deux autres établissements, qui ne mobilisent pas plus de cinq personnes chacun. Chez Pépé Nicolas, ils sont une trentaine d’employé·es.
Là où la nature reprend ses droits
À cette logistique compliquée, s’ajoutent les pépins du quotidien. Au Refuge de Porcherey, « pour l’eau, c’est la source qui décide. Alors quand elle est à sec, on remplit des jerrycans depuis la source du voisin pour la cuisine, et on fait fondre de la neige pour la plonge et les toilettes », raconte Loïc Audebert. Face à ces impondérables, leur plus grande qualité reste le flegme et l’adaptabilité : « Il y a quelques années, une chute de pierres nous a arraché la terrasse. On a fermé pendant six mois. Puis une autre a endommagé toutes les arrivées d’eau et d’électricité. Ce n’est pas grave, on se met au boulot et on refait », se souvient à son tour Thierry Couttet, qui se définit comme une personne « très zen », trouvant toujours solution à tout.

Refuge de Porcherey (Saint-Nicolas de Véroce)
© Julie Zane
Mais contre les aléas de la météo et du climat, bricolage et système D ne suffisent pas toujours… et les événements naturels impactent souvent directement leur chiffre d’affaires. En cas de mauvais temps, par exemple, Alexia Coste souligne que peu de gens sont motivés pour grimper. « S’il commence à faire moche plusieurs semaines autour du mois d’août, qui est la période où on fait vraiment le gros de notre chiffre estival, ça promet quelques petites nuits blanches ! » Alors pour surmonter ces obstacles, les deux gardiens du Refuge de Porcherey sont obligés de travailler dans des conditions extrêmes. « On pourrait faire une vingtaine de couverts le midi tous les jours de la saison, et être rentable. Mais avec tous les aléas, la météo, on est obligés de prendre des pics d’affluence à 50 couverts pour assurer », affirme Loïc Audebert, pourtant seul dans sa cuisine étriquée. Sapé avec une chemise de cuisine Lafont, des chaussures de rando et une paire de lunettes Oakley, le chef explique qu’en hiver, quand la météo fait des siennes, ils ouvrent les demi-pensions plus de deux soirs par semaine. Ce qui permet de faire tampon, car le couchage et le petit déjeuner engendrent une marge plus importante : « Le piège, c’est que si l’on fait plus de demi-pensions, on travaille plus longtemps. Du coup, ça génère des horaires plus compliqués. »

Refuge de Porcherey (Saint-Nicolas de Véroce)
© Julie Zane
Comme si ce n’était pas assez, le réchauffement climatique défie aussi les acquis d’aujourd’hui. « La piste qui mène au restaurant est exposée plein sud, et comme il y a de moins en moins de neige, elle est très souvent fermée », souligne Margot Suchet, l’arrière-petite-fille du pépé Nicolas. Une nouvelle fois, ils s’adaptent : « Grâce à la notoriété du domaine, on arrive quand même à avoir du monde. En revanche, ça nous oblige à mettre deux navettes à disposition des clients pour aller les chercher au pied des pistes. » Tandis qu’au Refuge de Porcherey, Alexia Coste et Loïc Audebert sont contraint·es de troquer leur motoneige pour des skis de rando. « Avec le manque de neige et l’humidité, la motoneige n’avance pas. On ne peut pas non plus monter en voiture car il y a des pistes qui coupent le chemin, donc on fait ce qu’on peut en ski de rando et on met tout sur le dos. » À l’inverse, en été, la canicule impacte l’activité agricole de Chez Pépé Nicolas. Mais Margot Suchet relativise, puisqu’elle peut désormais ouvrir les terrasses du restaurant le soir. C’est d’ailleurs toute cette logistique qui justifie les prix : pour un repas entrée-plat-dessert, il faut compter au minimum une quarantaine d’euros.
L’appel de la montagne
« À la fin de la saison, physiquement et mentalement, c’est chaud. D’où les coupures », confie Loïc Audebert, avant de plaisanter en avouant qu’il tutoie son ostéopathe. Malgré les contraintes, les angoisses, la précarité, la fatigue physique et mentale, les restaurateur·rices d’altitude profitent d’un mode de vie unique, qui continue de les faire vibrer : l’amour de la restauration, l’attachement au lieu, le calme de la montagne, la vue, le rythme saisonnier… Thierry Couttet abonde : « C’est une vie qui est particulière, mais merveilleuse. » La limite ? « Si on commence à avoir des pépins de santé… Je veux aussi pouvoir profiter de ma vie quand je serai vieille ! » avance Alexia Coste avec un grand sourire.
Mangeuse discrète mais redoutablement efficace, Julie Zane croque l’info et le gratin du chaud business pour le Fooding, tout en bouclant son master « Boire, Manger, Vivre » (tout un programme) à Sciences Po.