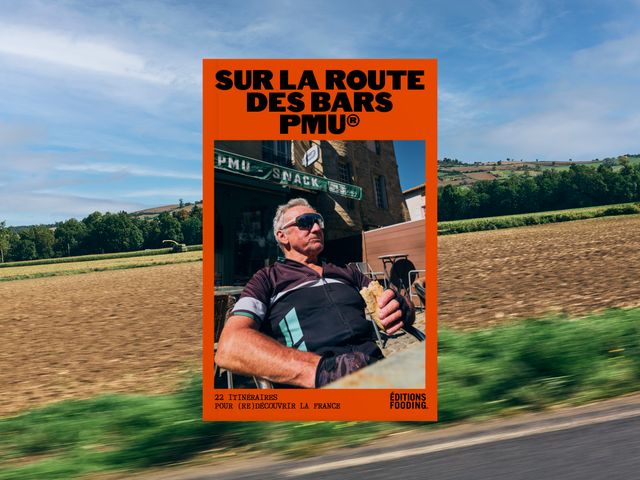« Des Café du Coin, il pourrait y en avoir à tous les coins. » Celui qui le dit est d’ailleurs coutumier du fait : Florent Ciccoli a contribué à ouvrir une flopée d’adresses de ce genre ces vingt dernières années. Son coin à lui ? Le onzième – mais il l’assure, il pourrait en être partout pareil. Peut-être pas avec le même carrelage fleuri ni les mêmes pizzette institutionnalisées, mais dans l’idée de ce plan d’habitué·es, inauguré fin 2017 et sacré l’année suivante « Meilleur café du coin » par le guide Fooding. Logique, nous direz-vous. Pourtant, en France, l’offre de rades (d’angle ou non) s’est peu à peu clairsemée : de 200 000 en 1960, ils sont passés à 40 000 aujourd’hui, d’après un récent article du Canard enchaîné. Dans la capitale, on n’en compte plus que 1 300, « juste de quoi entretenir la nostalgie d’un monde en fuite chez les Parisiens et faire fantasmer les visiteurs étrangers », selon l’hebdo.
Le Café du Coin appartient à une catégorie encore plus rare : celle des Café de Mars (ouvert en 2010) et Fontaine de Belleville (2016), troquets nostalgistes aux looks joliment déglingués sans avoir forcément subi le poids des années, servant une cuisine de jadis pas triste (des coupe-faims d’auteur aux produits bien castés) et renouant avec des horaires populaires, du kawa matinal au dernier verre de fin de soirée. Bref, des capsules temporelles, avec un accueil d’antan et une carte de maintenant, non-stop – des débits doudous aux valeurs sûres, qui rassurent dans une époque incertaine.
Et depuis la pandémie, les ouvertures parisiennes du même esprit s’enchaînent : le Café Les Deux Gares en 2020 (Meilleur bistrot du guide Fooding 2021), Paloma le mois de janvier suivant, Le Café des Délices peu de temps après, Le Cyrano, repris en 2022, ou plus récemment, Le Cornichon et Monaco, éclos au printemps 2024. Où l’on retrouve, comme le détaille notre article « Du petit matin aux grands soirs, le retour des cafés de quartier » : les codes traditionnels (zinc lustré, flipper vintage, nappes en papier), la carte au goût d’aujourd’hui (café de spécialité et assiettes sourcées) et ce petit supplément d’âme, qu’on appelle hospitalité. Et même si leur charme est parfois créé de toutes pièces (comme au Cornichon, imaginé avec l’agence d’archis Claves), qui cracherait sur un bouquet d’œillets posé au milieu d’une table ?
Bistronomie : n. f. De bistrot et gastronomie (2004). Néologisme, dû au critique gastronomique Sébastien Demorand (1969-2020) lors d’une réunion du Fooding en 2004, qui désigne le mouvement, né au début des années 1990 à la suite d’Yves Camdeborde, de chef·fes souvent fortifié·es aux grandes maisons et désireux·ses de démocratiser la gastronomie dans des « néobistrots » plus accessibles.
Souvent entre les mains de restaurateur·rices en série (plutôt que de chef·fes-proprios), les néocafés illustrent une nouvelle catégorie du (bien) boire et manger à la sauce Fooding : des buvettes à rebours des coffee shops scandi-boisés aux horaires bien cadrés (auscultés ici) et des néobistrots servant quatre ou cinq soirs par semaine. Un autre modèle, qui fait le lien entre les deux autres, se rêvant vivant et viable, malgré les horaires à rallonge. Un quart de siècle après le début de la révolution bistronomique (qui réactualisait elle aussi un genre bon et sans flonflons, gaillardement porté par votre guide préféré dès les années 2000) et au milieu d’une tombée de rideaux, tiendrait-on le triptyque d’avenir de la restauration française ?